[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
2 participants
 VikeutaurSoldat Rôliste
VikeutaurSoldat Rôliste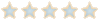
- Messages : 13
Date d'inscription : 06/04/2020
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Mer 8 Avr - 12:52
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Q0HETAM](https://i.imgur.com/q0HETAM.png)
DEUTSCHES REICH
Capitale : Berlin
Hymne : Deutschlandlied
Devise : Einigkeit und Recht und Freiheit
Forme de l'Etat : République fédérale constitutionnelle semi-présidentielle
Langue: Allemand
Proclamation de la République : 9 Novembre 1918
Monnaie :Papier-toilettePapiermark
Politique :
- Faction au pouvoir : Socialistes (35 points).
- Gauche : Communistes (15 pts).
- Droite : Libéraux (20 pts) / Nationalistes (15 pts).
Economie :
- Système économique : capitalisme libéral.
- Industrie civile : 48.
- Industrie militaire : 3.
- Dette : 102 or.
Forces armées :
- Armée : 10 divisions d’infanterie type 1920, 12 divisions de milice du Freikorps, 1 divisions de cavalerie hippomobile (obsolètes).
- Attachements divisionnaires : Aucun.
- Flotte : Aucune.
- Aviation : Aucune.
Modificateurs :
- Traité de Versailles (limite à 10 divisions d'infanterie et 1 divisions de cavalerie) : Illimitée (révocable via RP).
- Hyper-inflation (production d'or divisée par deux) : 4 ans restant (révocable via RP).
- Lassitude de guerre : 55%.
Gouvernement
Président du Reich : Friedrich Ebert (SPD - Depuis le 11 février 1919)
Chancelier du Reich : Gustav Bauer (SPD - Depuis le 21 juin 1919)
Composition du Cabinet Bauer : (En place depuis le 21 juin 1919)
Gustav Bauer (SPD) : chancelier du Reich
Matthias Erzberger (Zentrum) : vice-chancelier et ministre des Finances
Hermann Müller (SPD) : ministre des Affaires étrangères
Dr Eduard David (SPD) : ministre de l'Intérieur
Rudolf Wissell (SPD) : ministre de l'Économie
Robert Schmidt (SPD) : ministre de l'Alimentation
Dr Alexander Schlicke (SPD) : ministre du Travail
Dr Johannes Bell (Zentrum) : ministre des Transports et des Colonies
Johannes Giesberts (Zentrum) : ministre de la Poste
Wilhelm Mayer (Zentrum) : ministre du Trésor
Gustav Noske (SPD) : ministre de la Guerre
Otto Geßler (DDP) : ministre de la Reconstruction
Introduction rapide :
La proclamation de la république le 9 Novembre 1918 met un terme à l'existence du Reich Allemand proclamé en 1871. La défaite durant la guerre de 1914-1918 laisse une plaie béante dans la société allemande. Voulant depuis longtemps le pouvoir, le SPD y arrive mais se retrouve à devoir gérer les difficultés d'après-guerre. La mutinerie des marins à Kiel, la proclamation d'un pouvoir des conseils semblable à celui de la Russie Soviétique embrase le pays. Les années 1918 et 1919 sont deux années chaudes, où les socialistes au pouvoir décident d'écraser systématiquement l'opposition ouvrière et nouvellement communiste, en s'appuyant sur les vieux secteurs de la société, notamment les militaires. L'insurrection spartakiste est écrasée grâce à l'intervention des Corps-Francs début 1919 et les velléités révolutionnaires semblent s'estomper. Mais de nouveaux combats surgissent un peu partout dans le pays, culminant avec la proclamation de la République des Conseils de Bavière, qui finira également écrasé par le gouvernement et les freikorps. La république a mauvaise presse, principalement du côté des militaires et des nationalistes : Ces derniers ont inventé le mythe du "coup de poignard dans le dos" pour expliquer la défaite. En réalité, ils n'ont pas voulu accepter la défaite militaire et ont laissé les civils faire la sale besogne à leur place. Internationalement, l'Etat Allemand est un paria et essaye de limiter la casse à Versailles, afin de ne pas finir entièrement démembré. Mais les principales puissances alliés réclament des réparations, des changements de frontières ainsi qu'une limitation drastique de la capacité de nuisance de l'Allemagne vaincue. En somme, le destin de l'Allemagne au début des années 20 est sombre, sinon chaotique. Si le gouvernement tient pour le moment bon, l'agitation nationaliste d'un côté et communiste de l'autre pourrait plonger le pays dans la guerre civile, la révolution ou même la contre-révolution préventive.
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand BaQD4LP](https://i.imgur.com/BaQD4LP.png)
 VikeutaurSoldat Rôliste
VikeutaurSoldat Rôliste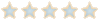
- Messages : 13
Date d'inscription : 06/04/2020
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Jeu 9 Avr - 16:48
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Q0HETAM](https://i.imgur.com/q0HETAM.png)
DEUTSCHES REICH
« Si l’empereur n’abdique pas, la révolution sociale est inévitable. Moi, je ne veux pas de cette révolution, je la hais comme le péché » Friedrich Ebert
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand AxVUVI6](https://i.imgur.com/AxVUVI6.png)
Les mutineries de Kiel, point de départ de la Révolution de Novembre 1918 en Allemagne
A s'y méprendre, l'instauration du régime républicain en Allemagne n'a pas fondamentalement changé les choses dans le pays. Derrière les changements comme l'adoption de la Constitution de Weimar, les vieilles structures de l'Allemagne Impériale semblaient tenir bon. La cohorte de généraux, de hobereaux prussiens ou de grands capitalistes continuaient d'exister et de reprendre leurs forces. La classe ouvrière allemande avait payée cher la longue année 1919, réprimé dans le sang, par les balles ou par les flammes. Le SPD qui s'était hissé au pouvoir en Novembre 1918, avait prétendu qu'il instaurerait le socialisme dans l'ordre des choses, sans avoir recours à la révolution. Sans doute la classe ouvrière pouvait-elle le croire encore au début de l'année 1919, mais à la toute fin de cette dernière ce n'était clairement plus le cas. Le SPD voulait d'ailleurs être le cœur du nouveau régime, de cette nouvelle "République de Weimar" comme on commence à la nommer : Après tout, les social-démocrates étaient au pouvoir non ? La proclamation de la république leur avait échappé des mains, en quelque sorte. Lorsque Liebknecht avait proclamé la république socialiste libre d'Allemagne, Scheidemann avait répondu en proclamant lui aussi depuis les balcons de la Chancellerie, la proclamation de la république. Fureur de son camarade de parti Friedrich Ebert, qui lui sermonna qu'il n'avait pas le droit de définir la nature du nouveau régime, avant qu'une Assemblée Constituante ne soit élue. Déjà, les problèmes semblaient être colossaux.
Lors des élections de Janvier 1919, le SPD raflait 37% des voix mais ne pouvait pas se positionner comme le seul et unique parti dominant au sein de l'assemblée. Il décide de s'allier avec le Parti du centre allemand (DZP - Zentrum) et le Parti démocrate allemand (DDP), qui récoltent respectivement 19,7 % et 18,6 % des suffrages, s'offrant une majorité large pour gouverner. Le Cabinet Scheidemann durera jusqu'en Juin 1919, avant de se retirer : Scheidemann refusera la proposition de paix émanant des Alliés, qui sera connu désormais comme étant le Traité de Versailles. Gustav Bauer le remplacera et de son côté, assurera la ratification prochaine du traité. Mais la situation économique, sociale et politique allemande est catastrophique. La défaite durant la guerre va amputer le territoire allemand à l'est, comme à l'ouest ainsi que ses maigres possessions coloniales. Des réparations vertigineuses vont être imposés, ainsi qu'une forte limitation des forces armées. Le SPD est le premier à être surpris. En effet, ses dirigeants pensaient que leurs protestations contre le traité leur permettrait de pouvoir discuter des termes plus favorables. Mais de l'autre côté du Rhin, les Français n'ont pas réellement envie de discuter. Le cas allemand montre alors très bien les contradictions entre les vainqueurs et entre les volontés britanniques, françaises et américaines sur le devenir de la balance des pouvoirs en Europe. D'abord intransigeante, la sociale-démocratie allemande se fera l'ardente défenseure de la signature du traité, lui vouant des inimitiés profondes de la part des milieux nationalistes et revanchards.
1919, une année terrible. L'insurrection spartakiste à Berlin avait été sauvagement réprimé par Gustav Noske, membre du SPD. Il avait déclaré à Ebert lorsqu'ils passaient en revue les corps-francs, qu'il serait le "chien sanglant" dont on aurait besoin pour mater la révolution. Les communistes allemands venaient tout juste de se créer, au sein du KPD. Petite organisation encore inexpérimentée, subissant l'influence du putschisme et des combats de rues, l'insurrection de 1919 sonnera comme un triste retour à la réalité. Le SPD se rangera définitivement du côté de l'ordre et de la contre-révolution, tandis que Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg - les deux leaders historiques de l'aile gauche allemande - finiront brutalement assassiné par l'alliance entre les militaires et la sociale-démocratie. Mais durant toute cette année, les insurrections et les grèves grondent. Dans la Ruhr, on appel à la grève générale. En Saxe, en Thuringe, à Hambourg... A chaque fois, les corps-francs interviennent pour remettre de l'ordre. D'avril à mai 1919, une république des conseils est proclamée en Bavière. Le temps s'arrête sur un instantané : Moscou - Budapest - Vienne - Munich. L'Europe tremble depuis que les coups de fusils d'Octobre 1917 ont placé au pouvoir les bolcheviks en Russie. Ces derniers appellent à la fin de la guerre et à un soulèvement général en Europe. L'Internationale du Travail va balayer le vieux monde ! En Hongrie, une république des conseils est proclamé. A Vienne, de durs combats opposants sociaux-démocrates et communistes à l'armée. A Munich, on s'organise dans le même sens. Malheureusement, toutes ces expériences succombent sous les bottes d'interventions étrangères, sous les balles et la Terreur Blanche. Le bilan est amer, mais pour les communistes russes comme allemandes, ce n'est qu'un prélude à la révolution mondiale. Ce n'est qu'une question de temps.
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand CDu6cRZ](https://i.imgur.com/cDu6cRZ.png)
Affiche du KPD, début de l'année 1920
La classe ouvrière allemande est-elle révolutionnaire ? Les années 1918 et 1919 semblent démontrés que les échecs révolutionnaires écartent définitivement toute possibilité de révolution dans le pays. Le SPD reste le parti majoritaire à gauche, alors que les communistes sont illégaux, pourchassés par la police et n'ont qu'une très faible base de masse pour agir convenablement. Entre le SPD et le KPD, se trouve une organisation qui a su profiter de la situation pour devenir importante : L'USPD. L'Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Parti Social-Démocrate Indépendant d'Allemagne) s'est crée en avril 1917, autour d'un groupe d'exclus du SPD qui refusaient de continuer à soutenir les crédits de guerre, voir la guerre tout court. Mais cette organisation nouvelle créer est rapidement traversée par des courants divers qui s'opposent. On retrouve des figures les plus à gauche comme Liebknecht et Luxembourg et des figures très à droite, comme Kautsky ou Bernstein. Si pour les premiers, il s'agit de créer une réelle organisation révolutionnaire, pour les seconds il s'agit de faire en sorte que l'USPD fasse revivre le SPD "d'avant", c'est à dire avant qu'il ne trahisse ses engagements contre la guerre tout en maintenant une ligne réformiste dure. L'USPD va participer au premier gouvernement avec le SPD en 1918, avant de basculer dans l'opposition. Aux élections de janvier 1919, il récolte seulement 7,6 % des voix, mais se place comme une alternative crédible là où le KPD - plongé dans une tactique gauchiste de boycott - refuse de participer aux élections et s'isole du reste de la classe ouvrière. Après cette tumultueuse année 1919, c'est bel et bien vers l'USPD que de nombreux ouvriers se dirigent. "L'USPD est la réelle organisation révolutionnaire", disent bon nombre d'entre eux. Pas le KPD donc, jugé comme une petite secte d'agitateurs, voulant faire le coup de poing mais incapable d'une stratégie sur le long terme.
Le KPD est une jeune organisation. Le Parti Communiste qui s'est crée à la toute fin de l'année 1918 et durant les premiers jours de 1919 souffre de nombreuses déviations politiques. Son principal problème réside dans sa composition de classe : Les membres qui y viennent sont souvent jeunes, sont passé du front à l'usine, de l'usine au chômage, du chômage à la volonté de faire la révolution. Très peu de militants sont des cadres avec une formation complète. Beaucoup rechignent à participer aux élections, à faire de l'agitation dans les syndicats. Une forte minorité gauchiste veut se lancer dans le coup de force, veut l'insurrection et l'instauration du pouvoir des conseils. Ils n'ont aucune envie de retourner à un style de travail légaliste et patient, qui leur rappel celui du SPD... Donc celui d'une organisation contre-révolutionnaire. Pour les tenants d'une réorganisation du KPD, il faut agir. La centrale à appelé à une conférence du Parti à Heidelberg, du 20 au 23 Octobre 1919. Paul Levi, Paul Frölich, Clara Zetkin, Heinrich Brandler veulent s'opposer aux thèses "gauchistes" et "syndicalistes" des Otto Rühle, Karl Becker, Wolffheim et Laufenberg. C'est une victoire pour Paul Levi, qui fait accepter ses thèses et rejette les positions gauchistes. Désormais, le KPD devra se rectifier et mener une politique moins aventuriste, travailler au près des masses et s'implanter où cela est nécessaire. Si Paul Levi gagne, Lénine n'est pas content du tout. Ce dernier aurait voulu éviter la scission, si possible. Karl Radek, envoyé des bolcheviks pour organiser les communistes allemands est sur la même ligne. Pourtant, le "mal" est déjà fait. Le KPD peut de nouveau se projeter vers l'avant.
De l'autre côté du spectre politique, les nationalistes, pangermanistes et les militaires attendent patiemment. Ils n'aiment pas le SPD. Ils n'aiment d'ailleurs pas la gauche en générale. Ce sont des "marxistes". Les nationalistes comprennent cependant que le SPD et les "marxistes" peuvent les aider dans leur tâche de réorganisation. Après tout, le SPD a accepté de signer le traité de Versailles, non ? Il en portera donc l'entière responsabilité. Les socialistes, juifs, marxistes, franc-maçons et autres éléments anti-nationaux sont les responsables de la défaite et de la débâcle. C'est le mythe du Dolchstoßlegende, le fameux coup de poignard dans le dos. L'armée, les milieux nationalistes et d'affaires s'innocentent totalement de ce qui s'est produit en Novembre 1918. Ce sont les civils qui ont signé la capitulation, qui ont accepté de faire tomber le régime du Kaiser et qui vont accepter l’infamie du traité de Versailles. Le moment venu, il sera temps de se débarrasser d’eux. Mais pour l'instant, ils remplissent parfaitement leurs rôles en épaulant les corps-francs pour mettre un terme à la menace de toute révolution dans le pays. Après l'écrasement de la république des conseils de Bavière, Munich devient le nouveau centre de l'extrême-droite allemande, derrière des gens comme Von Epp et où pullule des organisations nationalistes diverses et variés, comme le Deutsche Arbeiterpartei par exemple, étroitement surveillé par l'armée. La droite n'ose pas avancer, elle est encore trop horrifiée par la possibilité de l'agitation de la classe ouvrière, animé notamment par les succès bolcheviks dans les plaines russes. Il faudra patiemment déconstruire, puis détruire l'influence que le socialisme marxiste et internationaliste a pris sur la classe ouvrière. Sinon, aucune reconquête nationale ne sera possible, ni même envisageable.
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand O1xB3P8](https://i.imgur.com/O1xB3P8.png)
Le territoire national du Reich au moment de la signature du Traité de Versailles
L'application du Traité de Versailles est entré en vigueur le 21 janvier 1920, signifiant également la conclusion de la Conférence de la paix de Paris qui s'était ouverte en 1919 sous l'égide des principaux vainqueurs de la guerre. Les troupes allemandes commencent à évacuer Danzig, le Schleswig ainsi que la Haute-Silésie en vertu des accords signés. C'est sans aucun doute le moment le plus honteux ressenti par la population allemande, ainsi que par ceux qui l'a dirige. Humilié diplomatiquement et politiquement, la situation économique ne va guère dans un sens meilleur : La consommation de viande était tombée à 37 % de son niveau d’avant-guerre, la farine à 56 %, le café à 28 %. Les prix se retrouvent à être multipliés par dix, avec comme base ceux de 1913. Les grèves explosèrent drastiquement entre la fin de 1919 et 1920. Si les slogans révolutionnaires reculaient (notamment ceux sur la socialisation des mines ou des lieux de productions), les batailles pour les salaires étaient nombreuses et souvent victorieuses. Pour la seule année 1919, l'on comptait pas moins de 48 067 180 journées de grèves. Pour tenter d'enrayer le mouvement, Gustav Noske avait crée la Technische Nothilfe (Service Technique d'Urgence), qui devait assurer que les rouages essentiels de l'économie pouvaient tourner, quitte à utiliser des méthodes brutales pour casser les grèves. Durant les premiers jours de l'année, les indépendants (USPD) lancèrent une manifestation devant le Reichstag. La TN et les troupes firent feu, provoquant 42 morts et 105 blessés. Le gouvernement félicita la troupe et la TN pour avoir su gérer la situation convenablement. La situation n'était très certainement pas entrain de se calmer, mais elle semblait prendre une autre tendance qui finirait peut-être de nouveau par éclater de manière brutal, un autre moment.
Autre problème qui donne des sueurs froides aux nationalistes allemands, celui de leur châtiment. Les Alliés ont fait grand cas du fait qu'il faudrait châtier les hauts responsables de l'armée pour leur attitude durant la guerre et qu'un tribunal devrait se monter afin de pouvoir commencer à traiter les quelques cas que l'on connait. Pour le moment, des discussions s'ouvrent avec les autorités françaises afin de savoir le nombre exact de personnes qui pourraient passer en jugement et sur quel motif. Après les sueurs froides, ce sont les Alliés qui doivent également taper du pied. La France via son ambassade aux Pays-Bas a demander l'extradition du Kaiser Guillaume II, puisque ce dernier a trouvé refuge dans le pays après son abdication. Il devrait passer devant un tribunal pour 1. violation d'un traité en envahissant la Belgique, 2. permettre aux sous-marins allemands de couler des navires civils et 3. d'avoir utilisé du gaz de combat durant la guerre, d'après l'article 27 du Traité de Versailles. De manière surprenante, les Pays-Bas refusent. En Angleterre, David Lloyd George avait purement et simplement proposé de "pendre le Kaiser". Le Président des Etats-Unis Woodrow Wilson de son côté, s'est exprimé sur le sujet et était contre l'extradition du Kaiser, considérant que cela ne ferait que retarder la paix tant voulue sur le continent européen. Finalement, il semblerait que pour Guillaume II, son exil se passe pour le moins bien et à l'abri de toute extradition voulu par les Alliés. De quoi très certainement provoquer l'ire de nombreuses chancelleries et plus particulièrement de la France, qui a de quoi avoir la dent dure contre son principal ennemi et adversaire héréditaire.
 VikeutaurSoldat Rôliste
VikeutaurSoldat Rôliste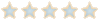
- Messages : 13
Date d'inscription : 06/04/2020
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Lun 13 Avr - 14:26
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Q0HETAM](https://i.imgur.com/q0HETAM.png)
DEUTSCHES REICH
« A Chemnitz, nous avons été le premier parti à lancer les mots d'ordre de grève générale, désarmement de la bourgeoisie, armement des ouvriers, réélection immédiate des conseils ouvriers politiques. Nous avons aussi été les premiers, grâce à la force du parti communiste, à faire passer ces mots d'ordre dans la réalité » Heinrich Brandler
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand CHPktwe](https://i.imgur.com/CHPktwe.png)
Wolfgang Kapp - Walther Freiherr von Lüttwitz - Hermann Ehrhard : Les trois figures centrales du "Putsch de Kapp"
Le 13 mars 1920 à quatre heures du matin, les hommes de la Brigade Ehrhardt pénètrent dans Berlin. Sans tirer un seul coup de feu, ils se rendent maître de la situation ainsi que de la ville. Le soutien tacite des forces de polices ainsi que des unités de l'armée leur est donné. Prenant les ministères, l'armée venait littéralement de chasser le gouvernement social-démocrate qui s'était appuyé sur lui durant toute l'année 1919. Un vieux bureaucrate prussien du nom de Wolfgang Kapp se proclame chancelier. Ce dernier représente les vieux intérêts monarchistes et les sentiments énormes des militaires et des nationalistes vis à vis de la république. Les soldats patrouillent dans les rues, les unités militaires et policières fraternisent, voir restent passives. L'ancien drapeau impérial est fièrement exhibé. La réussite semble totale car en quelques heures le coup réussit. Depuis de nombreux mois, des bruits circulaient sur la possibilité d'une action militaire contre le gouvernement. Gustav Noske, l'homme qui était devenu le grand protecteur de l'armée, croyait sincèrement que les militaires resteraient loyal à la république. Il avait passé de longs mois à bâtir une alliance solide avec l'Etat-Major, travaillant de concert pour faire interdire la presse du KPD et de l'USPD, réprimer les grèves et les mouvements sociaux. Quelques heures avant le putsch, Noske expliquait à l'un des ministres qu'il avait entièrement confiance dans l'armée et que cette dernière resterait loyale. Le putsch de Kapp lui a démontré le contraire. Noske totalement paniqué, demande l'intervention des unités loyales au gouvernement. Mais ces dernières n'ont rien fait. Pire, elles soutiennent tacitement le mouvement sans en prendre part. Von Seekt, dirigeant de l'armée, livre le fond de sa pensée à un Noske désemparé : La Reichswehr ne tirera pas sur la Reichswehr.
C'est la panique. Le gouvernement décide de s'en aller, sans demander son reste. Il va se fixer à Stuttgart, après avoir décidé de fuir Dresde qui n'était pas sûre. Le général Maercker ne leur offrant aucune protection, tout en refusant de se placer vis à vis du putsch à Berlin. Cette attitude est commune à l'ensemble de l'armée, qui regarde sans forcément agir, qui veut savoir si le putsch de Kapp va tenir sur le long terme. Une position médiane, une position de sûreté. Kapp de son côté, proclame l'état de siège, fait suspendre les journaux et nomme le général von Lüttwitz commandant en chef. Le putsch de Kapp répond à vrai dire à l'inquiétude des militaire. La ratification du traité de Versailles prive l'armée allemande de ses soldats, de son matériel et de son prestige. En juin 1919, Pabst avait déjà proposé à Noske une dictature militaire que ce dernier avait refusé. Début 1920, de nombreux freikorps dont la Légion Baltikum revenait au pays après s'être battu contre les bolcheviks dans les Pays Baltes. Pour les remercier, le gouvernement "marxiste" du SPD voulait désormais les dissoudre, reprendre leurs armes et les pousser vers la misère. Tout ces éléments ont provoqué le putsch, appuyé discrètement par la droite conservatrice comme le DNVP (Deutschnationale Volkspartei - Parti Populaire National Allemand) qui espère de nouvelles élections ainsi qu'une nouvelle majorité nationaliste et conservatrice au gouvernement. La confluence de l'ensemble de ces éléments permet la réussite du putsch de Kapp. Le gouvernement est en fuite, mais avant de partir il a lancé un appel à la mobilisation générale, afin de résister au putsch militaire. Le SPD majoritaire en appel à la classe ouvrière à résister contre les militaires... des militaires que le SPD majoritaire avait jusque là utilisé contre cette même classe ouvrière, présentant les militaires comme le seul rempart face à la subversion.
Gustav Noske s'est donné la mort durant la fuite du gouvernement [1] « Tout le monde m’a abandonné, il ne me reste plus que le suicide », écrit le dirigeant socialiste avant de se brûler la cervelle, totalement dépassé par les événements. La résistance s'organise cependant à Berlin et assez rapidement. A 11 heures du matin Carl Legien, vieux cacique du SPD, patriarche révisionniste et dirigeant de l'ADGB (Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund - Confédération Générale Syndicale Allemande) lance un appel à la grève générale. Il a fustigé le départ du gouvernement et est resté sur place, afin de lutter contre le putsch militaire. Il est épaulé par Otto Wels un autre membre du SPD, qui fait imprimer des tracts et des affiches afin d'appeler à la résistance, de lutter contre la réaction militaire et protéger la république. Le lendemain, le 14 mars, la grève générale est effective dans tout Berlin bien qu'il s'agisse d'un dimanche : A 17 heures, il n'y a plus ni trams, ni eau, ni gaz, ni électricité. Des échauffourées éclatent entre des ouvriers et des militaires. Comme une traînée de poudre, le mouvement de grève général comme à s'étendre. Dans la Ruhr, l'on met en place des conseils exécutifs où le SPD, l'USPD et le KPD travaillent de concert dans certains endroits, s'affrontent dans d'autres. Mais le mouvement de grève général est massivement suivi. A Leipzig, à Francfort, à Halle, Kiel, Chemnitz ou encore Dortmund, le mouvement s'intensifie et des combats armés éclatent. Dans la Ruhr ainsi que dans le centre de l'Allemagne, le mouvement est le plus fort et le plus structuré. Des réseaux de conseils ouvriers émergent, l'on proclame la dictature du prolétariat, la mise en place des mesures de socialisations. L'on commence à former des milices ouvrières, l'on s'affronte avec les gardes locales et bourgeoises. En quelques jours à peine, le putsch de Kapp vacille sous le poids d'une terrible grève générale qui rassemble plusieurs une dizaine de millions de travailleurs allemands.
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand MdHMrSJ](https://i.imgur.com/MdHMrSJ.png)
Dans la Ruhr, on s'organise : Photo d'un détachement de l'Armée Rouge de la Ruhr
Kapp ne peut rien faire. La grève générale puissante, l'empêche de faire quoi que ce soit. Il ne peut rien imprimer, ses ordres ne sont pas respectés. Il menace de faire tirer sur les manifestations et sur les regroupements. Mais rien n'y fait. Pire, des soldats se mutinent et il faut l'intervention des corps francs pour remettre de l'ordre. Le 18 Mars, tout est fini. Le putsch de Kapp aura duré environ cinq jours mais se sera confronté à un mur implacable, celui de la grève générale. Kapp et ses partisans décident de s'enfuir, tandis que le gouvernement est en chemin pour retrouver son poste. Mais, la grève générale n'est pas terminée, loin de là. Dans la Ruhr, les combats s'intensifient et les corps-francs sont durement combattus, voir expulsés de nombreuses villes. C'est à Hagen que tout est entrain de se jouer. Dès le 14 Mars, des milices ouvrières s'opposent au général von Watter et le repousse. Dans les jours qui suivent, le comité d'action de Hagen devient un point névralgique. Des centaines de milliers d'ouvriers sont en armes. Après des combats à Düsseldorf, les troupes de la dite "Armée Rouge de la Ruhr" met la main sur plus de 4000 fusils, 1000 mitrailleuses, des canons, des mortiers et des munitions diverses. Pour intégrer l'Armée Rouge de la Ruhr, il faut pouvoir démontrer que l'on appartient à une organisation ouvrière et syndicale et également démontrer que l'on a été en service dans l'armée pendant plus de six mois. L'annonce du soulèvement dans la Ruhr et la continuation de la grève générale est cependant un problème pour le gouvernement qui revient aux manettes : Schiffer au nom du gouvernement, lance des tracts par avion dans l'ensemble du pays : « La grève générale s'effondre – Faites front contre le bolchevisme qui anéantit tout » Non seulement le gouvernement cherche à protéger les membres compromis de la Reichswehr, mais elle compte de nouveau sur elle pour remettre de l'ordre.
Car Legien de son côté, avait sondé le SPD, l'USPD ainsi que le KPD afin de constituer un "gouvernement ouvrier". Pour Legien, le seul moyen de mettre un terme à la réaction et au militaire, serait de constituer un gouvernement qui intégrerait les organisations syndicales et permettrait l'unité large des socialistes, communistes et révolutionnaires. Le SPD refuse : Il y a un gouvernement, c'est le sien et il ne peut pas être reconnu si un parti bourgeois ne le soutient pas. L'USPD est gravement divisé entre son aile droite et son aile gauche. La droite avec Hilferding serait par exemple pour ce gouvernement, tandis que l'aile gauche refuse de siéger avec les "massacreurs des ouvriers". La gauche accuse la droite de vouloir chercher des places. La gauche de l'USPD ne voit rien d'autre dans ce "gouvernement ouvrier" qu'une répétition des gouvernements de 1918, où l'USPD avait formé avec Haase un gouvernement avec Ebert. Quand au KPD, il se perd dans ses mots d'ordres et n'a aucune influence concrète. Il s'oppose d'abord à la grève générale, ne parle pas de l'armement du prolétariat. Puis quelques jours plus tard, sa centrale change de position : Il faut se battre pour la constitution des conseils, de la dictature du prolétariat. Au moment où les discussions sont terminés - Legien a refusé le poste de chancelier proposé par Ebert -, le KPD accepte le principe du gouvernement ouvrier en se plaçant comme "opposition légale". Mais il est déjà trop tard. N'arrivant à se mettre d'accord, aucun compris n'est trouvé. Le 20 Mars, les organisations syndicales décident d'arrêter le mouvement de grève, après avoir discuté avec le gouvernement. Mais le mouvement ne s'arrête pas et au contraire, prend davantage d'intensité dans la Ruhr.
Les 23 et 24 Mars, des discussions se tiennent à Bielefeld entre Johannes Giesberts et Otto Braun pour le gouvernement, avec des représentants des conseils, des villes, municipalités, de Düsseldorf, Münster et Arnsberg, ainsi que les principaux partis politiques et des envoyés du KPD. Le mouvement dans la Ruhr n'est pas homogène politiquement. Hagen est un centre important, mais il est modéré en terme politique. Müllheim est par exemple dirigé par des anarcho-syndicalistes, qui refusent de s'allier avec l'USPD ou des membres du SPD qui veulent rejoindre le mouvement. A Duisbourg, des anarchistes gèrent la ville sans lien avec le reste des comités révolutionnaires. L'USPD est très bien présente dans le sud et l'est, là où les radicaux (communistes et syndicalistes) dominant à l'ouest. Cette dissension est la cause principale de l'échec du mouvement. Les Accords de Biefeld dirigé par Carl Severing permettent un cessez-le feu et de mettre en avant la possibilité de rendre les armes, tout en promettant des mesures politiques et sociales dans le nouveau gouvernement. Mais la discorde explose entre les différentes tendances révolutionnaires et réformistes dans la Ruhr : Hagen accepte les accords, là où la centrale de Essen la refuse. D'autres poussent pour de nouvelles négociations. Les envoyés du KPD plaident pour que les armes ne soient pas rendus, mais que les éléments de l'Armée Rouge de la Ruhr se tiennent sur des positions défensives. Mais trop tard, le mal est déjà fait. Le mouvement de grève s'estompe, les différentes centrales ne se coordonnent pas et la Reichswehr n'attend qu'un signal pour reprendre sa revanche dans la Ruhr, alors que des unités entières de l'Armée Rouge de la Ruhr accepte de déposer les armes. Après la témérité de la grève générale, le mouvement semble s'estomper et battre de l'aile. L'occasion semble manquée, par faute de direction révolutionnaire.
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand PyGb0JM](https://i.imgur.com/PyGb0JM.png)
Les partisans de Kapp et les troupes le soutenant, ici arborant le drapeau impérial
Le 27 mars 1920, alors que la situation reste toujours tendue dans le centre du pays ainsi que dans la Ruhr, le gouvernement Bauer tombe. Ce dernier ne peut plus siéger, pour la simple et bonne raison qu'il a été incapable de pouvoir s'opposer au putsch de Kapp. Le Président Ebert demande donc à Hermann Müller membre du SPD comme lui, de former un nouveau gouvernement. Comme précédemment le gouvernement sera composé du SPD, du Zentrum ainsi que du DDP, c'est à dire les trois principales forces principales qui détiennent la majorité à l'assemblée. Ce gouvernement s'est entendu avec les syndicats, mais a rejeté les demandes de Carl Legien sur la formation d'un "gouvernement ouvrier". En soi, le gouvernement cherche juste à changer quelques têtes dans le gouvernement, à Berlin ainsi qu'en Prusse sans fondamentalement chercher à réprimer ou écarter frontalement les personnes qui ont soutenu le putsch, même mollement. Le gouvernement Müller se donne comme tâche principale de calmer les syndicats, de remettre en avant le pays et de sortir de la crise dans laquelle il se trouve. Cela passe notamment par la réduction des agitations dans la Ruhr. Les ministères se remirent au travail, la chaîne de commandement au sein de l'administration commença de nouveau à fonctionner, et l'armée fut de nouveau confier à von Seeckt, celui là même qui avait décidé de ne pas intervenir durant le putsch de Kapp, prétextant que l'armée ne pouvait pas tirer sur l'armée. Pendant que le mouvement ouvrier organisé tergiversait, les politiciens bourgeois se remettait de leur frayeur et se préparaient à frapper à nouveau, afin de remettre de l'ordre dans le pays.
Gouvernement
Président du Reich : Friedrich Ebert (SPD - Depuis le 11 février 1919)
Chancelier du Reich : Hermann Müller (SPD - Depuis le 27 Mars 1920)
Composition du Cabinet Müller : (En place depuis le 27 Mars 1920)
Hermann Müller (SPD) : chancelier du Reich
Erich Koch-Weser (DDP) : vice-chancelier et ministre des l'Intérieur
Joseph Wirth (Zentrum) : ministre des finances
Adolf Köster (SPD) : ministre des affaires étrangères
Robert Schmidt (SPD) : ministre des affaires économiques
Alexander Schlicke (SPD) : ministre du travail
Andreas Blunck (DDP) : ministre de la justice
Otto Gessler (DDP) : ministre de la défense
Johannes Giesberts (Zentrum) : ministre de la poste
Johannes Bell (Zentrum) : ministre des transports
Andreas Hermes (Zentrum) : ministre de l'alimentation
Gustav Bauer (SPD) : ministre du Trésor
Eduard David (SPD) : ministre sans portefeuille
Vacant : ministre de la Reconstruction
[1] C'est un point de divergence avec IRL, ce fdp de Noske a pas eu le courage de se mettre une balle dans la tête. Suivant la méthode Tcherno d'une redoutable efficacité, la lancer est tombé sur pile. Manque de pot pour Noske, mais personne le regrettera.

 VikeutaurSoldat Rôliste
VikeutaurSoldat Rôliste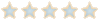
- Messages : 13
Date d'inscription : 06/04/2020
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Mer 15 Avr - 14:44
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Q0HETAM](https://i.imgur.com/q0HETAM.png)
DEUTSCHES REICH
« Au moment où Kapp-Lüttwitz ont fait leur putsch et mis en péril le régime Ebert-Bauer comme Spartakus ne l'avait jamais encore fait, on n'a pas osé appeler à lutter contre eux les armes à la main. Alors qu'on voulait se battre les armes à la main. Comment cela est-il possible? » Paul Levi
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand U39Wtcc](https://i.imgur.com/u39Wtcc.png)
Les freikorps, fer de lance dans la pacification de la Ruhr et l'écrasement du soulèvement révolutionnaire
Les accords de Bielefeld ont marqué le commencement de la fin de l'épopée révolutionnaire dans la Ruhr. N'arrivant pas à se mettre d'accord entre eux, les différentes tendances, organisations et structures révolutionnaires laissent un temps précieux à la Reichswehr pour se réorganiser. Alors que de nombreux conseils acceptent de déposer les armes, d'autres s'y refusent. Le conseil central d'Essen par exemple refuse de désarmer. Profitant de cette situation de chaos, le général von Watter - qui avait dû évacuer temporairement la région sous le coup des ouvriers en arme - lance un ultimatum au conseil d'Essen : Si dans vingt-quatre heures il ne lui aura pas été livré quatre canons lourds, dix légers, deux cents mitrailleuses, seize mortiers, vingt mille fusils, quatre cents caisses d'obus d'artillerie, six cents d'obus de mortiers, cent mille cartouches, il considérera que les dirigeants ouvriers ont refusé de désarmer leurs troupes et déchiré l'accord de Bielefeld. Le conseil d'Essen décide de répondre à cette provocation en appelant à nouveau à la grève générale. Mais la force de la grève était déjà retombé et les organisations de gauche trop désunis pour parvenir à un accord de principe. Entre les atermoiements de certains dirigeants et les surenchère gauchistes à Essen, il n'y a plus de coordination convenable. Le chancelier Müller brisa définitivement les illusions : En refusant de déposer les armes, le conseil d'Essen venait de rompre les accords signés à Bielefeld. Les dirigeants de l'Armée Rouge de la Ruhr avaient rompus leurs engagements. Les forces combinés de la Reichswehr ainsi que des freikorps allaient bientôt entrer en action et mettre un terme définitif à cette nouvelle poussée révolutionnaire. Alors que le putsch de Kapp avait été vaincu par l'action collective de la classe ouvrière, son manque de direction allait la faire perdre et se faire massacrer.
Un seul problème. L'entrée des troupes de la Reichswehr dans la Ruhr est une flagrante violation des accords de Versailles. Le gouvernement allemand a demandé le 2 avril au gouvernement français de pouvoir intervenir pour mettre un terme à l'insurrection. Le gouvernement français représenté par le Président du Conseil Alexandre fuckin' Millerand avait refusé et en apprenant leur entrée dans la zone, avait demandé qu'elles cessent leurs avances immédiatement. Le 4 avril, alors que les premiers combats entre les forces réactionnaires et révolutionnaires se poursuivent dans la Ruhr, le gouvernement français fait savoir qu'il enverra des troupes occuper Francfort, Darmstadt, Hambourg ainsi que Hanau en mesure de rétention. Deux jours plus tard le 6 avril, les troupes françaises dirigés par le Général Degoutte entrent à Darmstadt et Francfort, hissant le drapeau tricolore dans les deux villes. Le même jour, les troupes de la Reichswehr engagent des combats autour de Essen, le point chaud et le plus central de l'insurrection dans la Ruhr. Le 8 avril, le cabinet Müller se réunit et fait voter le retrait progressif des troupes allemandes de la Ruhr, qui devra se faire progressivement jusqu'à la fin du mois. Le 26 avril, le retrait sera effectif et total. Pendant ce temps dans la Ruhr, c'est un carnage. Bien que des mesures aient été prises pour éviter les exécutions sommaires, ces dernières se multiplient. Severing est horrifié par l'attitude des troupes. Des milliers de combattants de l'Armée Rouge de la Ruhr décident de fuir en se mettant en sécurité du côté français. Les militaires prenaient leur revanche, tuant par centaines des ouvriers, jetant dans des fosses communes des corps de femmes et d'enfants. Le bilan est lourd : Plus de 1000 victimes du côté des insurgés, 208 dans la Reichswehr et 273 pour les freikorps. La victoire est totale, le mouvement est écrasé.
L'extrême-gauche allemande ressort écrasée et encore plus divisée qu'avant. L'attitude vacillante de l'USPD entre sa droite et sa gauche, ont crée des situations difficiles et parfois dangereuses. Si les indépendants de gauche ont soutenu le mouvement, la droite essayait le plus souvent de maintenir les vieilles structures ou de s'associer avec le SPD majoritaire. Le KPD de son côté est totalement laminé, son influence baissant encore davantage. L'hésitation de la centrale, les tergiversations sur le gouvernement ouvrier, la signature des accords de Bielefeld renforcent les tenants de l'activisme et de l'action. Les "gauchistes" exclus par Levi et la majorité fin 1919 profitent de la situation pour s'unir. Malgré les grandes difficultés d'organisations, un congrès se tient le 3 avril 1920. Les représentants présent disent représenter plus de 38 000 membres : Le KAPD est né. (Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands - Parti Communiste Ouvrier d'Allemagne) Il se prononce pour la dictature du prolétariat, pour l'adhésion à la IIIème Internationale tout en s'opposant à la centrale du KPD, accusé de continuer à vouloir mener des politiques en faveur du parlementarisme, d'intégrer les syndicats et de refuser de se lancer dans un combat de classe déterminé. Le congrès du KPD qui se tient une dizaine de jour plus tard n'aborde même pas la question de la création du KAPD. Pour le KPD, cette création ne représente qu'une petite fraction du mouvement ouvrier allemand. Ce qui importe le plus, c'est de rallier les indécis et surtout, d'essayer de "gagner" l'aile gauche de l'USPD afin de s'unir avec elle. C'est là du moins que se trouve pour Paul Levi et une partie de la centrale, l'avenir du mouvement communiste en Allemagne. Le résultat des élections de Juin 1920 semble en tout cas donner raison à cette tendance qui se dessine au sein du KPD.
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand YIweQqL](https://i.imgur.com/YIweQqL.png)
Affiche du KPD pour les élections de Juin 1920 représentant Hugo Stinnes, un important industriel allemand
Les élections de Juin 1920 marquent un tournant important depuis la proclamation de la république. Pour la première fois, le SPD se mange une méchante rouste. S il arrive à se maintenir en gardant le plus grand nombre de siège dans l'assemblée, il perd plus d'un tiers de ces derniers depuis les dernières élections. Qui en profite ? Principalement l'USPD, qui ramène à lui l'ensemble des mécontents de la politique du SPD et qui semble représenter les intérêts de la classe ouvrière, qui se reconnait désormais en son sein. Le Zentrum ainsi que le Parti Démocrate s'effondrent littéralement, mettant à mal la coalition de Weimar qui régnait depuis plusieurs années maintenant. Si l'USPD profite de l'effondrement du SPD, la droite profite de l'effondrement des partis centristes et démocratiques : Le DNVP et le DVP prennent une centaine de sièges à eux deux. Le non-ralliement des forces conservatrices et nationalistes au putsch de Kapp semble leur avoir profité. Le KPD lui fait un score modeste, mais fait entrer pour la première fois des députés au sein de l'assemblée, au nombre de quatre. La situation politique change alors brutalement. Qui va gouverner le pays et avec quelle majorité ? Le 8 Juin, Müller offre au Président Ebert sa démission. Ce dernier souhaite qu'il attende le temps qu'une coalition puisse être trouvé. Dans un premier temps, le SPD semble refuser une alliance avec le DVP et lance un appel à l'USPD pour former un gouvernement, tout en lui demandant de mettre de côté ses "velléités révolutionnaires". Mais ce dernier refuse laissant les discussions se poursuivre. Il faut attendre le 25 Juin pour qu'un gouvernement soit constitué autour de Constantin Fehrenbach, membre du Zentrum. Après une première tentative quelques jours avant de former un premier gouvernement, il parvient à mettre sur pied une coalition tenable.
Ainsi, le Cabinet Fehrenbach va pour la première fois bousculer les alliances politiques des premiers temps de la république. Sa coalition gouvernementale est composée du Zentrum, du DDP, du DVP ainsi que de quelques indépendants. Si le SPD ne siège pas, il n'en reste pas moins le garant tacite qu'un tel gouvernement puisse exister. Il lui apporte son soutien, sans lequel il ne pourrait de toute manière pas exister. Mais la polarité politique semble être désormais atteinte, plus que jamais. Les ouvriers ont massivement lâché le SPD pour se tourner vers l'USPD, tandis que les secteurs les plus réactionnaires et nationalistes ont décidé de favoriser le DVP et le DNVP. Ils s'opposent au gouvernement vis à vis de la gestion du Traité de Versailles ou jugent qu'il est responsable des troubles révolutionnaires dans la Ruhr. Il y a quelques mois en Bavière, une obscure formation politique s'est crée autour de 25 points d'unités, regroupé autour d'Anton Draxler et d'un certain Adolf Hitler : Le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemand est né (NSDAP). La Bavière est devenue un important terreau et une base importante pour l'extrême-droite nationaliste allemande. Le gouvernement social-démocrate de Hoffman avait été remplacé sous pression du Parti du Peuple Bavarois d'un certain Kahr. C'est ce dernier qui a offert asile et protection à de nombreuses personnalités qui craignaient d'être attaqués pour leur participation au putsch de Kapp. La montée de la violence politique était palpable. L'USPD voyait ses effectifs passés de 300 000 membres en 1919 à plus de 800 000 au courant de l'été 1920. Le KPD rassemblait péniblement d'après ses chiffres à peu près 70 000 membres, sans compter les chiffres avancés par sa scission du KAPD. Pour la classe ouvrière allemande, c'était bel et bien l'USPD qui représentait les réalités révolutionnaires et clairement pas le KPD, organisation jugée insignifiante et n'ayant aucune emprise sur la réalité, en dehors de quelques bastions dans le centre de l'Allemagne comme à Chemnitz.
Gouvernement
Président du Reich : Friedrich Ebert (SPD - Depuis le 11 février 1919)
Chancelier du Reich : Constantin Fehrenbach (Zentrum - Depuis le 25 Juin 1920)
Composition du Cabinet Fehrenbach : (En place depuis le 25 Juin 1920)
Constantin Fehrenbach (Zentrum) : chancelier du Reich
Rudolf Heinze (DVP) : vice-chancelier et ministre de la justice
Joseph Wirth (Zentrum) : ministre des finances
Walter Simons (Ind) : ministre des affaires étrangères
Erich Koch-Weser (DDP) : ministre de l'intérieur
Ernst Scholz (DVP) : ministre des affaires économiques
Andreas Hermes (Zentrum) : ministre de l'alimentation
Heinrich Brauns (Zentrum) : ministre du travail
Otto Gessler (DDP) : ministre de la défense
Wilhelm Groener (Ind) : ministre des transports
Johannes Giesberts (Zentrum) : ministre de la poste
Hans von Raumer (DVP) : ministre du Trésor
Vacant : ministre de la Reconstruction
 VikeutaurSoldat Rôliste
VikeutaurSoldat Rôliste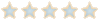
- Messages : 13
Date d'inscription : 06/04/2020
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Sam 18 Avr - 14:11
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Q0HETAM](https://i.imgur.com/q0HETAM.png)
DEUTSCHES REICH
« Aujourd'hui, en 1920, après toutes les faillites et les crises honteuses de la guerre et des premières années qui l'ont suivie, il est clair que, de tous les partis d'Occident, c'est précisément la social-démocratie révolutionnaire d'Allemagne qui a donné les meilleurs chefs, qui s'est guérie, qui a repris ses forces avant les autres. On le voit aussi bien pour le parti spartakiste et pour l'aile gauche du parti social-démocrate indépendant d'Allemagne qui mène une lutte sans défaillance contre l'opportunisme et la faiblesse des Kautsky, des Hilferding, des Ledebour et des Crispien » Lénine
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand HB0IbXQ](https://i.imgur.com/hB0IbXQ.png)
Le Présidium de l'IC lors de son deuxième congrès. On peut y voir Trotski, Rosmer (France), Levi (Allemagne), Zinoviev, Boukharine, Kalinine et Radek
L'année 1920 semblait être une année de grande espérance. Le souffle de la révolution mondiale semblait débouler en pleine Europe, sous les coups de boutoirs de l'Armée Rouge des Ouvriers et des Paysans. Alors que le 1er Congrès du Comintern avait vu un nombre restreint de représentants internationaux être présent, son 2ème Congrès qui s'ouvre au mois de juillet 1920 voit arriver des représentants de tous les coins du monde. Mais l'ambiance euphorique qui animait les plus téméraires et les partisans de "l'offensive révolutionnaire" semble s'être éteinte. En acceptant la proposition de Lord Curzon de terminer son avance le long de la dite "Ligne Curzon" en Pologne, la direction soviétique semblait faire un compromis acceptable... mais qui semblait retarder l'avènement de la révolution mondiale. Si Lénine pensait qu'il était possible de pouvoir avancer vers l'ouest pour permettre d'étendre la révolution, que Toukhatchevski clamait que "Le feu de la révolution mondiale passe par le cadavre de la Pologne réactionnaire", d'autres dirigeants bolcheviques restaient plus prudent : Trotski n'était pas partisan de l'invasion de la Pologne, Karl Radek y était hostile car il pensait que la classe ouvrière polonaise se se soulèverait pas. Le commissaire du peuple aux nationalités Staline était également de cet avis, pensant même tout bonnement que jamais la Pologne - pour cause de contentieux historiques - n'accepterait d'entrer dans une fédération commune avec la Russie. Paul Levi - dirigeant de la centrale du KPD - avait enfoncé le clou en expliquant à Lénine que l'avancée de l'Armée Rouge ne provoquerait pas un soulèvement généralisé. Pour un temps, la rythme de la révolution mondiale semblait se calmer. La nécessité de la réorganisation était nécessaire, tandis qu'il fallait prendre des forces. L'Allemagne dans cette perspective, jouait un rôle important. C'est par elle que les espoirs d'un incendie mondiale existait. Mais l'échec du soulèvement de la Ruhr et les tergiversations de la centrale du KPD vis à vis de la réponse politique au putsch de Kapp avait brisé cet espoir.
Mais tout n'était pas perdu, loin de là. Au cours de l'été 1920, l'USPD était gravement agité en son sein. Non pas à cause de la politique du KPD - qui était inexistant, sa forme même de Parti était combattu par Brandler par exemple - mais plutôt à cause de l'activité nouvelle de l'Internationale Communiste. En somme, les trois organisations actives en Allemagne se sont retrouvés à Moscou. L'USPD, le KPD ainsi que le KAPD. Ce dernier est clairement la scission "gauchiste" du KPD, bien que dans le fond son opposition au KPD ainsi qu'aux positions de l'Internationale Communiste serait plutôt une critique de l'organisation bolchevique qu'il serait impensable de transposer en Europe. Lénine avait répondu aux gauchistes par un livre qui allait devenir célèbre, La maladie infantile du communisme : Le gauchisme. Il y critiquait les positions "ultras", c'est à dire le refus de participer aux syndicats, d'utiliser la tribune parlementaire, de mener un long travail dans les masses afin de les gagner. Lénine y critiquait à la fois les positions du KAPD, tout comme il s'en prenait aux éléments les plus à droite qui pouvaient exister dans l'USPD par exemple. Au congrès, la lutte de ligne est âpre. Le KAPD parvient à se faire accepter comme une organisation sympathisante. L'USPD de son côté est divisé, une fois de plus. Dittmann et Crispien pour l'aile droite, s'opposent aux 21 conditions et tergiversent sur les méthodes organisationnels, considérant que si ils devaient les accepter l'USPD serait obligé de ne plus être un parti légal. Ils seraient pour l'adhésion, tout en pinaillant. Ce qui n'est pas le cas de son aile gauche représenté par Däumig et Stocker, qui pensent qu'il faille provoquer la scission avec la droite de l'USPD, se rallier au KPD et ensuite pleinement accepter l'adhésion au sein de l'Internationale Communiste. Le débat est long et indécis, pourtant il faudra bien trancher. Le prochain congrès de l'USPD qui se tiendra en dans les prochains mois, devra trancher définitivement sur cette question.
Pour Paul Levi, c'est une occasion en or. Si il montre clairement son désaccord vis à vis de l'attitude de l'IC vis à vis du KAPD - puisqu'il a été responsable de leur éviction en 1919 - il pense nécessaire de mener la lutte pour rallier la majorité de l'USPD au sein du KPD. C'est pour lui, le seul et unique moyen de pouvoir transformer profondément le KPD et de le faire passer de petite secte agitatrice, à une puissante organisation de masse. Car ce qu'il manque clairement aux communistes, c'est un appareil et une masse ouvrière capable de se mettre sous leur direction. Car au grand dam des communistes, c'est bel et bien l'USPD qui est considéré comme le point de rencontre de la gauche révolutionnaire, de la gauche communiste. Les dissensions qui existent au sein de l'USPD et qui se matérialisent lors des discussions pur l'admission, tranchent définitivement la stratégie générale. De nombreux militants de l'aile gauche de l'USPD sont d'ailleurs optimistes et clament que lors du prochain congrès, ils auront la majorité. A partir de là, ils pourront emporter l'indécision, scissionner et se préparer à rejoindre le KPD et l'Internationale Communiste. C'est le cœur de la bataille, une bataille pour gagner la majorité des indépendants. Au retour de Moscou, la rupture semble pour le moins consommé entre les quatre délégués. Däumig et Stoecker (pour la gauche) se prononcent pour l'acceptation pure et simple des vingt et une conditions, donc préparer la scission et la fusion prochaine avec le KPD. Dittmann et Crispien (pour la droite) se prononcent de leur côté pour le rejet pur et simple des vingt et une conditions, vitupérant le "centralisme" ainsi que la "dictature moscovite". C'est une véritable course contre la montre, car l'aile droite et l'aile gauche se répondent pied à pied, continuellement. La montée en puissance de l'aile gauche inquiète la droite et une partie de la direction : Il faut au plus vite organiser un congrès et arrêter l'hémorragie. Cinq semaines seront nécessaires pour préparer le congrès et permette qu'il se tienne. Les débats sont passionnants et animés, le KPD soutenant l'aile gauche tandis que l'aile droite peut s'appuyer sur les dirigeants syndicaux et une partie de l'appareil, qui attaque les scissionnistes comme étant téléguidé par Moscou. Tout va se jouer à Halle, lors du congrès d'octobre.
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand QYa06Hj](https://i.imgur.com/qYa06Hj.png)
"Demandez le Drapeau Rouge, l'organe centrale du VKPD !"
Lorsque s'ouvre le 12 octobre 1920 le congrès de l'USPD, la scission semble déjà être consommé. La parité entre la gauche et la droite est présente partout, que ce soit dans la tribune comme dans la répartition des mandats. Pour mener la lutte, l'Internationale a dépêché Zinoviev ainsi que Lozovsky, militant syndicaliste révolutionnaire. La droite a décidé de faire appel à Julius Martov, menchevik opposant à Lénine, Longuet petit-fils de Marx ou encore Henderson, chef de fil des sociaux-chauvins. L'ambiance est lourde, mais l'exaltation est là : Les militants de l'USPD ainsi que les délégués savent qu'ils vivent un moment important pour le mouvement socialiste allemand. Le début du congrès s'ouvre sur la prise de parole des différents délégués envoyé au 2ème Congrès de l'IC, c'est à dire Crispien, Däumig, Dittmann et Stoecker. Mais il ne s'agit là que de quelques escarmouches. Les choses sérieuses commencent quand Zinoviev vient pour prendre la parole. Pendant quatre heures (!) et en allemand - langue qu'il maîtrise très sommairement et péniblement -, Zinoviev va sonner la charge et tenter de rallier une majorité à ses positions. D'emblée il balaye l'argument qui ferait de l'adoption des vingt et une conditions la cause des dissensions. Il déclare notamment : « Nous sommes en train de réaliser la scission, non parce que vous voulez, au lieu de vingt et une, dix-huit conditions, mais parce que nous sommes en désaccord sur la question de la révolution mondiale, de la démocratie et de la dictature du prolétariat » Son discours vise à faire adopter à l'USPD les vingt et une conditions, mais également à se préparer pour la lutte à venir. La révolution frappe à la porte, elle est actuellement entrain de mûrir partout. L'Allemagne est le point central, c'est là que tout va se jouer prochainement. « Nous sommes en 1847 ! », lance plein de fureur le président du Comintern. C'est Hilferding qui doit répondre à Zinoviev. C'est un bon théoricien, mais pas un grand orateur. Zinoviev l'a contraint à se mettre sur la défensive. Mais il attaque subtilement, notamment en évoquant les débats entre Rosa Luxembourg et Lénine il y a une quinzaine d'années, sur la question de la centralisation du Parti et de l'executif. Il se veut réaliste, déclarant que les visées des bolcheviques ne sont qu'un « jeu de banco, un pari sur lequel on ne peut pas construire un parti » Il s'attaque encore aux communistes qu'il juge responsable de la possible scission et parle d'une Internationale centralisée comme d'une dangereuses utopie. Les dés sont jetés. Martov intervient et avec passion, crache sur les bolcheviques tout en condamnant le Comintern comme étant "entre les mains des russes". A terme, et par 237 voix contre 156, le congrès vote pour l'acceptation des vingt et une conditions, donc l'adhésion au Comintern. De fait, cela veut dire entamer des négociations pour la fusion avec du KPD. La droite furieuse, refuse le vote et conteste la possibilité de voter pour détruire l'organisation, qu'ils vont d'ailleurs garder. Expulsé d'Allemagne quelques jours plus tard, Zinoviev note : « La scission était nécessaire, inévitable : elle s'est produite. Il nous reste à dire : mieux vaut tard que jamais! » Pour les communistes allemands tout comme pour le Comintern, c'est une victoire importante et majeure.
Le KPD s'est préparé à la scission. Après le 2ème Congrès de l'IC, il s'était renommé en liquidant la référence à Spartakus et en s'intitulant "Section allemande de l'Internationale Communiste". La scission de la gauche de l'USPD est une victoire, sans doute la plus grande depuis que ce même USPD s'était crée au milieu des tumultes de la 1ère guerre mondiale. La droite de l'USPD qui reste à la tête de l'organisation, vacille. Son appareil est trop important pour les militants qui restent en son sein. Suite au congrès, de nombreux militants et délégués vont d'ailleurs choisir de retourner au SPD. L'USPD a fait son temps... L'aile gauche se constituant de manière indépendante, commence à éditer son propre journal. A la fois du moins d'octobre, le KPD appel la nouvelle gauche indépendante à discuter de la fusion à venir. Si la presse du SPD triomphe en expliquant qu'il s'agit de la fin de l'USPD, Levi triomphe également en répondant que c'est le début de la propagation du communisme en Allemagne, sur des bases solides. L'USPD comptait 800 000 adhérents. 400 000 vont rejoindre les communistes. C'est moins que ce qui était espéré, mais de nombreux militants ont tout simplement refusé de poursuivre leurs activités politiques, marqué par ces dernières années de luttes intenses et meurtrières. Cela n'empêche pas la tenue du congrès d'unification en Décembre 1920, dans une atmosphère d'optimisme. Ce congrès sonne comme une revanche sur les déboires du mouvement révolutionnaire allemand, depuis 1918. Ce congrès semble être clairement une revanche sur celui de 1919, qui avait vu la naissance du KPD. Désormais, le nouveau parti s'intitule V.K.P.D. (Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands ou Parti Communiste Unifié d'Allemagne) et réuni en son sein des éléments hétéroclites, allant des vieux combattants proches de Rosa Luxembourg, aux militants révolutionnaires à la base, ainsi qu'à de nombreux intellectuels comme Levi. Ce dernier aurait d'ailleurs souhaité se mettre en retrait, mais la pression de la base était impossible. Il accepte de diriger la destinée de la nouvelle organisation. C'est un triomphe personnel pour Paul Levi, ainsi que ses conceptions propres pour l'implantation du communisme en Allemagne.
Autre lueur d'espoir, au cours de l'été. Le KAPD a tenu son congrès durant les premiers jours d’août 1920. Il décide de se séparer d'éléments trop instables, voir qui commence à dévier dangereusement vers des positions nationalistes. C'est le cas de Wolffheim et Laufenberg à Hambourg, qui deviennent partisan de ce qu'ils nomment le "national-bolchevisme", conception visant à rejeter la lutte des classes et plaidant pour une unité totale entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, pour la reprise de la guerre contre les forces de l'Entente dans le cadre d'une "guerre de libération nationale", en alliance avec la Russie Soviétique. Otto Rühle qui tenait des positions anti-parti, contre l'Internationale et contre les bolchevique, est également exclu. Ses positions dévient d'ailleurs de plus en plus vers l'anarchisme et l'anarcho-syndicalisme. De nombreuses personnalités au sein du KAPD veulent tenter de nouveau un rapprochement avec le Comintern, après avoir fait le ménage en son sein. Schröder, Gorter et Rasch partent en fin de l'année à Moscou, afin de discuter avec l’exécutif pour ouvrir de nouvelles discussions et possiblement de pouvoir adhérer. En attendant, Paul Levi compte façonner le VKPD selon ses conceptions : Les gauchistes attendront. Pour lui, la fondation du VKPD est une première en Europe et peut-être un indicateur pour les mouvements révolutionnaires du monde entier. Il se montre critique sur la stricte application des méthodes bolcheviques, jugeant que la situation nationale et historique n'est pas la même, que le mouvement révolutionnaire mondial est traversé de contradictions qui font que le rythme de la révolution mondial est inégal suivant les pays. Si il loue les méthodes d'organisations pratiques des camarades russes, il pense que l'application trop stricte de leurs principes pourraient mener à de nouvelles défaites. En somme, Paul Levi est content de l'issu du 2ème Congrès en terme de lutte contre le gauchisme, tout comme il pense que le travail de la conquête du prolétariat allemand peut enfin commencer, avec la nouvelle structure du VKPD, capable de s'adresser largement à la classe ouvrière. Pourtant, les conceptions de Levi posent des problèmes frontaux vis à vis de la ligne d'application des vingt et une conditions : Là où Levi veut renouer avec la tradition social-démocrate allemande tout en développant des perspectives révolutionnaires claires, de conquête des masses ouvrières par un appareil puissant et organisé, la conception de l'IC est celle d'un parti communiste fortement centralisé, avec une discipline de fer et une organisation militaire clandestine. Tôt ou tard, la contradiction sera trop forte. Mais pour le moment, c'est l'optimisme qui est présent.
 VikeutaurSoldat Rôliste
VikeutaurSoldat Rôliste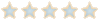
- Messages : 13
Date d'inscription : 06/04/2020
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Mer 22 Avr - 14:47
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Q0HETAM](https://i.imgur.com/q0HETAM.png)
DEUTSCHES REICH
« Aujourd'hui, pour la première fois, nous voyons et nous sentons que nous ne sommes pas si immédiatement près du but, la conquête du pouvoir, la révolution mondiale. En 1919, nous disions : « C'est une question de mois. » Aujourd'hui nous disons ; « C'est peut-être une question d'années » Trotski
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand EXa6MR8](https://i.imgur.com/EXa6MR8.png)
Caricature américaine, singeant le paiement des réparations demandé aux allemands
"Les Gouvernements alliés et associés déclarent et l'Allemagne reconnaît que l'Allemagne et ses alliés sont responsables, pour les avoir causés, de toutes les pertes et de tous les dommages subis par les Gouvernements alliés et associés et leurs nationaux en conséquence de la guerre, qui leur a été imposée par l'agression de l'Allemagne et de ses alliés." L'article 231 du Traité de Versailles est la pierre angulaire de la politique des alliés vis à vis de l'Allemagne. On exige des réparations, parfois des indemnités. Pour ses adversaires, il s'agit ni plus ni moins que d'un diktat. La première moitié de l'année 1921 est une guerre incessante pour statuer sur le règlement des réparations. En janvier, la conférence de Paris fixe à 226 milliards de marks-or le montant des réparations. L'Allemagne refuse, mais propose une contre-proposition en proposant 30 milliards de marks-or, comme base de discussion. Pendant plusieurs mois, le jeu diplomatique est pour le moins... tendu. La Conférence de Londres marque la rupture totale des discussions. L'Allemagne fait plusieurs contre-propositions, qui sont toutes rejetés par le gouvernement allemand. On fixe le montant total à 132 milliards de marks-or compte non tenu du remplacement des valeurs détruites, le montant de la dette allemande, en annuités fixes de 2 milliards de marks-or, majorés d'une indemnité variable égale à 26 % du montant des exportations allemandes. En outre, l'Allemagne doit s'acquitter du règlement de 50 milliards. Puisqu'elle refuse, les troupes françaises occupent Düsseldorf, Ruhrort, Duisbourg le 8 mai 1921. La position du gouvernement allemand est double : D'un côté, l’Erfüllungspolitik (la politique d’accomplissement) qui consiste purement et simplement à faire respecter les termes du Traité de Versailles en espérant qu'à terme, les alliés acceptent la révision des traités. De l'autre, l'utilisation de la Katastrophenpolitik (politique de catastrophe) qui comme son nom l'indique, est une tactique visant à provoquer constamment des défauts de paiements afin d'obliger par la force des choses, à une révision des traités. En tant que tel, ces deux politiques ne se contredisent pas et peuvent même être utilisé conjointement.
Les désaccords politiques entre les principaux alliés aide également l'Allemagne, puisque les trois principales puissances victorieuses ne sont pas d'accord sur la conduite à avoir. Le gouvernement françaismené par un gars qui est capable de venir lui-même chercher les réparations à coups de paires de baffesentend bien venger l'humiliation qui a été fait dans les mines du Nord, puisque les troupes allemands ont littéralement saccagé et détruit les mines. Pour les industriels français, les réparations vont servir de remettre en état la production, tout en permettant de relancer la production des fonderies de Lorraine qui sont revenus sous le giron français. L'industrie allemande elle, couine sévèrement : Elle a perdue une bonne partie du bassin de Haute-Silésie, tandis qu'elle doit fournir des quantités énormes de charbon à la France. Pour l'industrie du charbon anglais, c'est une catastrophe. Les livrais de l'Allemagne font que la moitié des exportations anglaises vers la France diminuent. Les besoins mutuels entre l'industrie lourde allemande et française, pourrait permettre à terme la constitution d'un trust franco-allemand sur l'acier, la coke ou le charbon, ce qui évincerait définitivement les anglais du marché européenne... donc la perte d'un débouché ô combien important pour ses exportations métallurgiques. Quand aux Etats-Unisqui veulent faire chier comme à leur habitude, ils s'opposent à ces plans principalement parce qu'il faut... sauver l'Allemagne. Le gouvernement américain essaye de tempérer l'ardeur de la France, notamment en faisant diminuer la somme totale des réparations et également renoncer au morcellement de l'Allemagne. (Car en scred, la France travailler à faire la sécession de la région rhénane, les petits coquins...) Bref, l'impérialisme américain est prêt à fournir à l'Allemagne vaincue les capitaux pour lui permettre de se relever économiquement et donc, à pouvoir payer ses réparations. A terme, la Grande-Bretagne va certainement se rallier au point de vue des Etats-Unis, principalement contre l'impérialisme français et ses volontés d'un nouveau "système continental".
Le cabinet Fehrenbach lui, s'écroule le 4 mai 1920. La conférence de Londres de mars ainsi que ses multiples pressions, ont fait volé en éclat le gouvernement. Le DVP se refuse à soutenir le ministre des affaires étrangères Walter Simons dans sa volonté de vouloir proposer de nouvelles contre-propositions aux Alliés. Va falloir signer et vite maintenant. Alors qu'une nouvelle insurrection polonaise se déroule en Silésie (Mais qui va finir comme les autres, écraser pendant que les alliés envoyés sur place pour superviser le dernier référendum tourneront le dos afin de ne rien voir) le 4 mai, le Fehrenbach jette l'éponge. Le président Ebert demande cependant au gouvernement de rester en place, le temps qu'un nouveau gouvernement puisse se constituer. Le 10 mai, c'est le ministre des finances Joseph Wirth qui prend la tête d'un nouveau cabinet. C'est le retour de la "coalition de Weimar" au pouvoir, c'est à dire le SPD, le Zentrum ainsi que le DDP. La situation est brûlante, car les alliés à Londres commencent à s'impatienter : C'est le "Londoner Ultimatum", qui demande que le 11 Mai, le gouvernement allemand accepte entièrement les réparations de guerre ainsi que les mensualités, se plie à un désarmement strict suite aux dispositions du Traité de Versailles et d'ouvrir les procès contre les crimes de guerre. Si le gouvernement allemand n'acceptent pas, les alliés vont occuper toute la Ruhr. Les débats sont houleux, car les différents partis politiques ne sont pas d'accord sur la constitution du nouveau cabinet, ainsi que la latitude à accepter l'ultimatum. Pourtant, un compris se fait principalement grâce au soutien apporté par l'USPD au sein de l'assemblée, puisque la coalition du SPD, du Zentrum et du DDP ne disposent pas d'une majorité nécessaire à ce moment là. En acceptant de se plier à l'ultimatum, le gouvernement allemand éviter une humiliation de plus.
Gouvernement
Président du Reich : Friedrich Ebert (SPD - Depuis le 11 février 1919)
Chancelier du Reich : Joseph Wirth (Zentrum - Depuis le 10 mai 1921)
Composition du Cabinet Wirth : (En place depuis le 10 Mai 1920)
Joseph Wirth (Zentrum) : chancelier du Reich et ministre des finances
Friedrich Rosen (Ind) : ministre des affaires étrangères
Georg Gradnauer (SPD) : ministre de l'intérieur
Robert Schmidt (SPD) : ministre des affaires économiques
Eugen Schiffer (DDP) : ministre de la justice
Andreas Hermes (Zentrum) : ministre de l'alimentation
Heinrich Brauns (Zentrum) : ministre du travail
Otto Gessler (DDP) : ministre de la défense
Wilhelm Groener (Ind) : ministre des transports
Johannes Giesberts (Zentrum) : ministre de la poste
Gustav Bauer (SPD) : ministre du Trésor
Walther Rathenau (DDP) : ministre de la Reconstruction
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand DZWKkfA](https://i.imgur.com/DZWKkfA.png)
Max Hoelz, le "Robin des bois rouge"
La politique nouvelle du VKPD n'est pas du goût de tout le monde. Paul Levi dispose d'une majorité somme toute relative au sein de la centrale. Le dernier Congrès de l'Internationale Communiste semble avoir fait courber les divagations sur l'offensive révolutionnaire et la nécessité de passer à l'action partout, continuellement. Pourtant au sein du Parti, une nouvelle gauche (essentiellement autour de Berlin) tenter de se reformer autour de figures comme Maslow ou Ruth Fischer. Certains veulent des prises d'initiatives et accusent Levi de mener une politique opportuniste. Des crispations politiques et idéologiques existent notamment entre l’exécutif de l'Internationale et Levi, sur la mise en place des méthodes d'organisations. Levi reste persuadé que l'implantation "pur" des méthodes russes ne fonctionnera pas. Il faut mener un long travail politique, d'implantation dans les syndicats et de se battre pour l'unité à la base. Levi note qu'énormément de travailleurs restent encore persuadé que les communistes sont des scissionnistes, que si ils étaient resté au sein du SPD, ils auraient une majorité parlementaire qui leur permettrait d'atteindre le socialisme... Il faut alors se battre, pour gagner cette majorité aux idées révolutionnaires. autre divergence, l'intégration du KAPD comme "parti sympathisant" au sein du Comintern. Il n'y a pas de place pour deux organisations communistes en Allemagne. La situation est simple : Ou le KAPD rejoindra le KPD, ou alors il dégénérera par refus de devenir une véritable organisation communiste. « Il n'y a en toute logique que deux issues à cette situation. A la longue, il est impossible d'avoir deux partis dans un seul pays. Ou bien le K.A.P.D. se transformera réellement en un parti communiste d'Allemagne, ou bien il cessera de faire parti des nôtres même comme sympathisant seulement », note Zinoviev. La situation est donc compliqué. De plus, Levi commence à critiquer les ingérences de l'Internationale en envoyant des délégués sur place, forçant parfois le cours des choses. Si il plaide pour la centralisation, il est contre cette tendance "lourde" qu'à l’exécutif à ne pas faire confiance aux partis communistes.
Autour de Halle et de Merseberg en plein cœur de l'Allemagne Centrale, le VKPD est plus implanté que jamais. C'est l'un de ses bastions les plus importants et les plus organisés. Les communistes parvenaient d'ailleurs occasionnellement à faire plus de voix que les deux partis socialistes (SPD et USPD), comme lors des élections du Land en février 1921. Pourtant, cela n'était pas uniforme partout. Dans d'autres endroits, les communistes se développaient également et possédaient toujours des places fortes comme à Hambourg ou encore à Stuttgart. Là, disposant d'un noyau important et d'une implantation dans les syndicats, ils relaient une "lettre ouverte", appelant à l'unité du prolétariat afin de lutter sur les points suivants : Baisse des prix des produits alimentaires, inventaire de la production et augmentation des allocations de chômage, diminution des impôts sur les salaires et imposition des grosses fortunes, contrôle par les ouvriers des fournitures de matières premières et de ravitaillement, ainsi que de leur répartition, désarmement des bandes réactionnaires et armement du prolétariat. La centrale du VKPD relaie, mais très rapidement les organisations syndicales majoritaires refusent de suivre cet appel. Qu'importe, les communistes ont montré leur détermination à se battre pour l'unité la plus large possible, dans un front unique de classe. Cependant, la "lettre ouverte" est critiquée par le KAPD, qui l'a juge et "opportuniste, démagogique et génératrice d'illusions". La gauche du VKPD attaque Levi à ce moment là, mais Radek et Zinoviev font taire les critiques, tandis que Boukharine - depuis que Bela Kun est entrain de s'amuser au Turkestan - parle dans le vent. La lettre ouverte est critiqué, mais Lénine soutien l'initiative de toutes ses forces. Il considère que c'est un document important pour le mouvement ouvrier allemand, ainsi qu'une tentative claire de dégager un plan de travail efficace.
Mais fin mars, l'agitation est malgré tout importante dans l'Allemagne Centrale. Max Hoelz resurgit alors, après avoir été en exil en Tchécoslovaquie. C'est un ancien soldat passé au communisme, durant la période révolutionnaire de 1918-1919. Il a été exclu du KPD pour ses positions putschistes et aujourd'hui, travaille avec le KAPD. Ce dernier est également fort dans la région et mène une agitation en faveur d'une grève générale, ainsi qu'un possiblement armement du prolétariat. Max Hoelz s'est bâti une réelle légende dans la région : Durant le putsch de Kapp, il a organisé des bandes armées qu'il a qualifié "d'Armée Rouge" et effectué des expropriations, des attaques de prisons ainsi que du rançonnement de bourgeois. Déjà à l'époque, il avait été condamné par la direction communiste comme un bandit. De retour dans la région en mars, il se relance dans l'agitation révolutionnaire, distribue des armes et tente le rapport de force. Quelques grèves éclatent, mais elles ne sont pas suivi par la majorité des ouvriers. Le KAPD pousse et demande au VKPD de le suivre : Ce dernier refuse, notamment sur l'insistance de Levi. Le KAPD tente alors pour tous les moyens nécessaire de faire se soulever nationalement le prolétariat allemand, quitte à provoquer des affrontements dans les usines qui refusent la grève. C'est un échec total et au bout de quelques jours, le mouvement se tasse. Le KAPD est furieux et se plaint auprès du Comintern de la position défaitiste du VKPD. Hoelz est quand à lui capturer par les forces de police et va passer en jugement dans les semaines à venir : Il prend une peine à perpétuité, tout en ne reniant aucunement son engagement communiste ainsi qu sa volonté de voir advenir une révolution prolétarienne en Allemagne. Levi et la centrale du VKPD condamnent les agissements du KAPD, mais apportent leur soutien à Max Hoelz, face à la répression de l'Etat. La division semble définitivement acquise entre le VKPD et le KAPD. [1]
Le 26 Août 1921 à Bad Griesbach, Matthias Erzberger est assassiné par deux jeunes hommes qui lui tirent dessus : Heinrich Tillessen et Heinrich Schulz. Erzberger était depuis longtemps hait par la droite allemande et les nationalistes, principalement parce qu'il avait été celui qui avait signé le Traité de Versailles. Il était également un timide réformateur, représentant l'aile progressiste du Zentrum. Il travaillait notamment sur un nouveau système d'impôt, cherchant à trouver un équilibre et un système de répartition réellement efficace. Il avait déjà il y a peu, faillit être assassiné. Sa mort provoque de grandes manifestations et notamment une union contre la montée de la droite nationaliste, qui se profile au cours de l'année 1921. Jusque là absente depuis l'échec du putsch de Kapp, la droite commence à reprendre des forces. Les succès électoraux du DVP avait commencé à lui donner un nouvel élan. L'assassinat de Erzberger par deux nationalistes, membre de l'Organisation Consul (Formé à partir des restes de la brigade Ehrhardt qui avait participé au putsch de Kapp), fait monter la violence politique dans le pays d'un cran. Quelques jours plus tard, Karl Gareis un membre de l'USPD, est également assassiné en pleine rue. Si rien ne semble indiqué que l'Organisation Consul a participé à l'assassinat, les suspicions sont nombreuses. La Bavière devient de plus en plus la forteresse de l'extrême-droite allemande, notamment autour du NSDAP qui commence à gagner de l'influence et atteindre plusieurs dizaines de milliers d'adhérents. Sa rhétorique contre le diktat de Versailles, contre les traîtres qui ont détruit l'Allemagne ainsi que l'emprise des juifs sur la vie économique et politique, commence à gagner du terrain. De plus, les nouvelles agitations ouvrières et révolutionnaires durant le mois de mars 1921 font se poser des questions à la droite nationaliste, ainsi qu'à ses bailleurs de fonds industriels : Ne faut-il pas en finir avec la république ?
[1] Divergence majeure avec IRL, il n'y a pas la dite "Action de Mars" qui a littéralement conduit à des scissions au sein du VKPD et explosé son influence dans le pays, conduisant à un sacré bordel politique pour la suite.
 VikeutaurSoldat Rôliste
VikeutaurSoldat Rôliste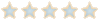
- Messages : 13
Date d'inscription : 06/04/2020
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Ven 24 Avr - 19:16
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Q0HETAM](https://i.imgur.com/q0HETAM.png)
DEUTSCHES REICH
« Je suis ainsi fait, j’aime mieux commettre une injustice que de souffrir le désordre » Johann Wolfgang von Goethe
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand YbLzAhH](https://i.imgur.com/YbLzAhH.png)
"Silésiens faîtes attention ! La mort de votre prospérité arrive !" - Affiche de 1921 sur le plébiscite en Haute-Silésie
La rectification de la frontière germano-polonaise doit être selon l'article 88 du Traité de Versailles, supervisés par les Alliés. Un vote doit avoir lieu et décider de son rattachement à l'un des deux pays. Au début de 1920, la France et la Grande-Bretagne sont une fois de plus en désaccord. Pour la France, il faut une Pologne forte et capable d'être un rempart contre le bolchévisme. Donc, il faut lui rattacher la Haute-Silésie où se trouvent une industrie et d'importantes richesses minières. Pour la Grande-Bretagne au contraire, cette région doit revenir à l'Allemagne : De là viendra son relèvement économique et sa possibilité de pouvoir au plus vite payer les réparations. La situation est compliquée dans la région : Par trois fois - en Août 1919, en Août 1920 ainsi que de Mai à Juillet 1921 -, les populations polonaises se soulèvent et il fait l'intervention des Alliés et de la SDN pour permettre que la situation ne dégénère pas davantage. A ce moment là, les anglais accusent les représentants français d'encourager les polonais à se soulever, car les français soutiennent le rattachement de la région à la Pologne. Pour couper court à la montée des tensions, on décide de la mise en place du référendum. Le 11 juillet 1920, un plébiscite avait déjà eu lieu dans la province d'Allenstein en Prusse-Orientale : A une écrasante majorité, la province vota pour rester allemande. Sans doute la même chose va se produire en Haute-Silésie : Les minorités allemandes subissent les vexations polonaises, tandis que la Reichswehr intervient au cours des insurrections pour calmer les mineurs et les paysans polonais.
La situation ne peut pas durer éternellement. Il y a en tout, 1 186 758 votants et le ration en faveur des allemands est de 60/40. Comme cela était prévisible, c'est le résultat qui fini par ressortir : 59.6% en faveut du maintien au sein de l'Allemagne. Dès le mois d'avril et de mai, la troisième insurrection polonaise se produit. Elle est réprimée, mais le fond de l'air reste très très chaud. Du côté des Alliés, ont continue de se battre. Finalement, il est décidé que la Société des Nations trancherait. Elle va effectivement trancher et évidemment, n'importe comment. En Octobre 1921, la SDN tranche : L’Allemagne conserve les deux tiers du territoire et la Pologne reçoit le sud, avec une population correspondant globalement à 20 000 voix de plus que les 480 000 voix polonaises du plébiscite. Kattowitz, Königshütte, Tarnowitz et Lublinitz reviennent à la Pologne mais la ville de Beuthen reste à l’Allemagne. La région industrielle est ainsi divisée, la Pologne recevant la plupart des mines, soit 82 % de la production de charbon, la presque totalité de la production du minerai de fer et 80 % de la production de zinc. Les Polonais sortent vainqueur, les Français exultent. Mais le cabinet Wirth lui, s'effondre : Il refuse ce qu'il nomme l'ultimatum de Genève. Le Président Ebert essaye de presser Wirth à constituer un nouveau cabinet, cette fois avec le DDP ainsi que les nationalistes du DVP. Mais ces derniers refusent - dans un premier temps - car le gouvernement s'est plié devant l'ultimatum de la SDN, laissant littéralement un territoire allemand se faire annexer. Wirth décide de former son gouvernement autour du SPD et du Zentrum, mais déclare qu'il veut former un gouvernement d'individus et non de partis. Quelques changements ont alors lieu, et le DDP accepte de rester dans le gouvernement. Mais l'Allemagne s'est une fois de plus fait marcher dessus.
Gouvernement
Président du Reich : Friedrich Ebert (SPD - Depuis le 11 février 1919)
Chancelier du Reich : Joseph Wirth (Zentrum - Depuis le 26 octobre 1921)
Composition du Cabinet Wirth : (En place depuis le 26 octobre 1921)
Joseph Wirth (Zentrum) : chancelier du Reich
Walther Rathenau (DDP) : ministre des affaires étrangères
Adolf Köster (SPD) : ministre de l'intérieur
Robert Schmidt (SPD) : ministre des affaires économiques
Gustav Radbruch (SPD) : ministre de la justice
Andreas Hermes (Zentrum) : ministre des finances
Anton Fehr (BB) : ministre de l'alimentation
Heinrich Brauns (Zentrum) : ministre du travail
Otto Gessler (DDP) : ministre de la défense
Wilhelm Groener (Ind) : ministre des transports
Johannes Giesberts (Zentrum) : ministre de la poste
Gustav Bauer (SPD) : ministre du Trésor et premier du chancelier du Reich
Vacent : ministre de la Reconstruction
 Denis freedomSoldat Rôliste
Denis freedomSoldat Rôliste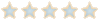
- Messages : 1
Date d'inscription : 20/05/2020
Pays Joué : Allemagne
![[Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand Empty](https://2img.net/i/empty.gif) Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Re: [Fiche] Deutsches Reich - Reich Allemand
Mer 20 Mai - 19:38
Nation reprise
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum|
|
|

